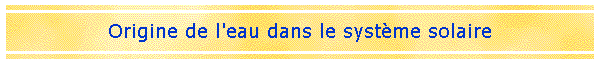
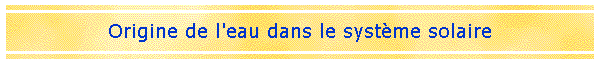
I L'eau, une molécule simple La
célèbre molécule d’eau H2O est comme son nom l ‘indique,
composée d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène. Or,
l’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’Univers, dont il
constitue les trois quarts de la masse visible. Quant à l’oxygène, il vient
en troisième position dans la balance de l’Univers avec 1 % de la masse,
juste après l’hélium qui représente 25 %. Idéalement,
il suffirait d’une rencontre entre un atome d’oxygène et de deux atomes
d’hydrogène pour faire une molécule d’eau. Hélas, les choses ne sont pas
si simples et H2O, comme la plupart des molécules, est plutôt
capricieuse. Il faut des conditions physiques et chimiques particulières pour
qu’apparaissent les molécules d’eau. II L'eau, une molécule difficile à obtenir Trois
grandes conditions président à la naissance d’une molécule d’eau. La
première condition réside dans une température adéquate ; Pas trop
chaude car les liaisons entre les atomes de n’importe quelle molécule ne résistent
pas à l’extrême agitation qui existe au-delà de quelques milliers de degrés.
Impossible donc à l’eau d’apparaître au cœur des étoiles, où la température
se compte en millions de degrés. Pas trop froide non plus, car, à l’inverse,
la rareté des atomes et de leurs mouvements au sein des étendues glacées rend
improbable la rencontre des atomes à marier. Donc, la température est un
facteur très important dans l’apparition d’eau. La
deuxième condition est liée à une bonne protection contre le rayonnement.
Pour exister, les molécules doivent être protégées du très énergétique
rayonnement ultraviolet qui baigne l’Univers et détruit les liaisons
chimiques entre les atomes. C’est pourquoi à peine 1 % de l’Univers est
sous forme moléculaire. Nous verrons dans la suite une exemple des conséquences
d’un rayonnement appliqué aux
molécules avec la planète Vénus. Enfin,
la troisième condition demande un subtil environnement chimique. En réalité,
la molécule d’eau ne résulte pas directement de la rencontre entre atomes
d’oxygène et d’hydrogène : elle est le produit d’une longue chaîne
de réactions voyant apparaître des molécules comme OH, O2, CO et
divers autres oxydes. Finalement,
après ce parcours du combattant, les molécules de vapeur d’eau ne représentent
qu’environ un millionième de la masse de l’Univers. Mais
alors, se pose la question de savoir où les atomes d’oxygène et d’hydrogène
trouvent-ils un endroit propice à
l’apparition d’eau ? En
fait, l’eau apparaît dans les nébuleuses. Les nébuleuses sont de
gigantesques nuages de gaz où se forment les étoiles et plus tard la nébuleuse
planétaire constituée de silicates et de matériaux comme le fer qui donnera
naissance aux planètes. Dans ces nuages, la pression est faible. Cependant,
dans les premières phases de son existence, une étoile expulse des jets de gaz
à grande vitesse. Ceux-ci créent des ondes de choc qui compriment et échauffent
les gaz du nuage interstellaire composé d’hydrogène, d’hélium, d’oxygène
et d’autres éléments en mois grande quantité. Porté à une température
supérieure à 100 °C, le gaz interstellaire vit alors se déclencher des réactions
chimiques qui finissent par transformer en vapeur d’eau la majeure partie des
atomes d’oxygène. Donc,
l’eau de l’Univers se créée dans les nébuleuses. III L'eau dans le système solaire Nous
en arrivons donc à l’eau dans le système solaire. Au
sein de cette nébuleuse, l’eau ne s’est pas formée de manière uniforme. En
effet, il règne un gradient de température et de pression entre le centre où
il faut chaud et où la pression est faible et la périphérie, froide et à
pression extrêmement basse. Ainsi,
au centre de la nébuleuse, ne sont solides que les molécules réfractaires
c’est à dire qui résistent à certaines influences physiques et chimiques.
Plus vers la périphérie, ces mêmes molécules peuvent s’hydrater. Par
exemple, l’olivine devient de la serpentine. Du fer devient du Fe(OH)2.
Enfin, encore plus loin vers la périphérie, ces poussières silicatées et
oxydées se recouvrent d’un épais manchon de glaces, la glace d’H2O
étant prédominante, associée là où il faut le plus froid à de la glace
d’ammoniac ou de méthane. Cette
répartition explique en partie la composition actuelle du système solaire. Les
planètes telluriques, dans le système solaire interne, ainsi que leurs
satellites sont formés à partir des éléments du centre et du milieu de la nébuleuse.
Leur formation se fait par accrétion, ce qui donne finalement des planètes
constituées principalement de silicates, de fer mais de très peu d’eau. Au
contraire, les autres planètes et plus particulièrement les satellites et les
petits corps du système solaire externe ont été formé à partir des matériaux
de la partie éloignée de la nébuleuse. Ceci a pour conséquence
l’apparition de corps dits ganymédiens du nom du satellite Ganymède qui est
le modèle de ces corps. Depuis, certains satellites ont perdu toute cette eau
mais certains comme Europe l’ont gardé et cachent peut-être un océan. Les
planètes gazeuses sont comme leur nom l’indique sont entouré de gaz. Mais à
leur centre, il existe un noyau qui était à l’origine un objet ganymédien.
Plus tard, la forte gravité de ces objets a attiré les gaz comme l’Hélium
et l’Hydrogène. Mais
alors si les planètes telluriques étaient constituées en majorité de
silicates et de fer, comment la Terre par exemple est-elle devenue la planète
bleue ? Deux
origines sont possibles à cette eau : -
La première a pour origine l’accrétion. En effet, il ne faut pas
oublier que les planètes telluriques se sont aussi formées à partir du milieu
de la nébuleuse où étaient présents beaucoup de molécules hydratées. Lors
de l’accrétion, la chaleur (chaleur d’accrétion et chaleur radioactive) a
provoqué la fusion des silicates et du fer. C’est d’ailleurs ce phénomène
qui a permis la différenciation des planètes telluriques. Sous cette chaleur,
les molécules d’eau se sont détachées des silicates et du fer pour migrer
vers la surface. Cette eau est appelée eau de dégazage -
Mais cette eau de dégazage n’explique pas encore la quantité d’eau
présente sur les planètes. Après l’accrétion, les planètes du système
solaire interne ont connu un bombardement intense. Elles ont en effet été
touchées par des nombreux corps à orbite elliptique dont beaucoup venaient du
système solaire externe. Cette provenance explique que ces corps étaient
riches en eau (voir ci dessus). Ces
corps très hydratés sont par exemple les comètes dont nous reparlerons par la
suite. Cette eau de deuxième génération s’est ajoutée à l’eau de dégazage, et il y a actuellement un grand débat non clos pour chiffrer la part relative de ces deux origines. L’eau de dégazage semble quand même majoritaire.
|
Idéalement, il suffirait qu'un atome d'oxygène, relativement abondant rencontre deux atomes d'hydrogène pour qu'une molécule d'eau soit créée. Mais en fait, cette eau n'est pas si abondante dans l'Univers.
Une nébuleuse diffuse Dans cette nébuleuse, se produisent de nombreuses réactions donnant naissance à une étoile mais aussi à des molécules d'eau.
Une nébuleuse planétaire Dans ce disque, sont en train de se créer des planètes par accrétion et peut-être aussi une autre "Terre" !
Un cratère d'impact : certains scientifiques pensent que l'eau vient de l'espace
Pourquoi notre planète est-elle recouverte d'eau alors qu'elle devrait être sèche et aride ? (Lac de l'Ontario - Vue de Mars d'après la mission Mars Pathfinder) |
|